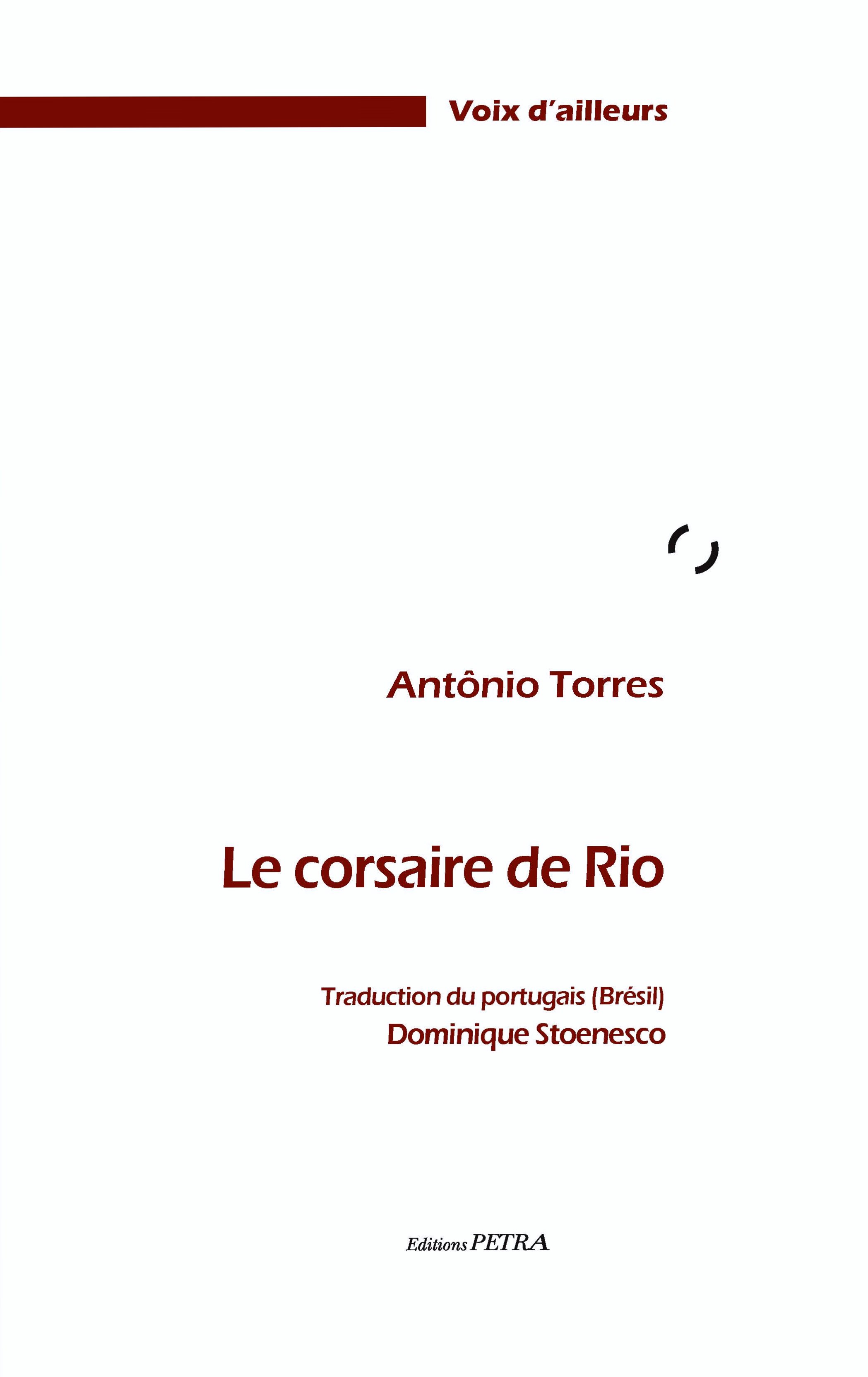-
18.00€
Le 12 septembre 1711, profitant d'une brume épaisse qui empêchait les canons portugais de l'atteindre, le corsaire malouin Duguay-Trouin pénètre dans la baie de Rio de Janeiro, à la tête d'une escadre de 17 navires, 750 canons et plus de 5 000 hommes et, pendant cinquante jours, va assiéger l'une des villes les plus convoitées de l'empire colonial lusitanien, puis y régner en seigneur absolu.
« Enfreignant les conventions et le protocole littéraire, le corsaire de Louis XIV et Antonio Torres, personnages de ce roman, s'entretiennent en tête-à-tête, se faisant les yeux doux tout au long de ce récit, comme s'ils vivaient à la même époque et se connaissaient depuis trois cents ans. Revivant les expériences propres à leur nation respective, ils se racontent l'un l'autre avec suffisamment d'art et d'invention pour tenir le lecteur en haleine de la première à la dernière page. » Lidia Jorge
Début de l'ouvrage
J'ai beau regarder, je ne vois pas Niterói
Saint-Malo, 6 février 2002
Quand le monde appartenait aux marins, moi, René, fils de Marguerite Boscher et du commandant de vaisseaux Luc Trouin, je ne suis pas parti en mer dès que je me suis vu adulte, comme tu pourrais l’imaginer, toi, qui es venu de loin, de là-bas du Brésil – de Rio de Janeiro ! – toi qui as traversé l’Atlantique et qui as tourné pas mal dans le coin, en voiture et en train, t’aventurant sur des chemins qui, espérais-tu, devaient te mettre sur la trace de mes pas dans cette France fatiguée de tant de guerres, Paris-Bordeaux, Bordeaux-La Rochelle, La Rochelle-Rochefort, puis Paris-Nantes, et de Nantes jusqu’ici, à Saint-Malo – mets un chapeau sur le o pour que les Brésiliens puissent prononcer correctement le nom de cette ville –, Saint-Malô, là où commence et où s’achève l’histoire de ce corsaire légendaire de Sa Majesté Très Chrétienne Louis xiv, le Roi Soleil, moi, René Duguay-Trouin, lieutenant-général des Forces Armées Navales, immortalisé dans le bronze, au sommet de la gloire sur ces célèbres remparts, label de Saint-Malo, me voici au panthéon de la splendeur du temps des marins, posté face à la mer, Saint-Malo d’où je n’aurais jamais voulu être parti, depuis ce jour où je me suis habitué à la mer, par la force des choses, mais, allons-y, tu es venu jusqu’ici pour recueillir mes mémoires, car je suis également un personnage malchanceux de l’histoire de ton pays, allez, approche-toi, je ne mords plus, regarde-moi, tu peux prendre des photos comme les Japonais, clic-clac, qu’est-ce qu’ils sont bruyants ces gens-là, bien moins pourtant que tes compatriotes brésiliens, ah, le Brésil, là-bas j’ai été roi, à l’époque des Portugais, j’avais le pouvoir et des femmes pour me distraire, servies au lit sur un plateau, un pouvoir conquis par le fer et le feu, et le pouvoir est aphrodisiaque, pas vrai ?, exotique, drôle, canaille, riche et injuste Brésil, dit-on de lui ici, et je le dis moi aussi, encore aujourd’hui, il est le pays de mes rêves, si convoité, le pauvre, une exubérance étourdissante, une extrême langueur et si peu de rigueur, le mot espérance rime avec intempérance, ô ! tropiques divins et profanes, un monde d’aventuriers, ouvert à tous les pillages, à tous les trafics, là-bas même les fleurs et les couleurs rendent fou, entre l’exaltation patriotique, les soumissions qui oppriment et la rébellion anarchique, les crocs-en-jambe à chaque pas, la peur à chaque coin de rue, un couteau sur la gorge, un pistolet sur la nuque, des balles perdues, le Brésil n’est pas un pays, c’est une démesure, par son immensité, sa lumière, ses saveurs, sa fameuse ginga* et sa folie, c’est un pays où la vie, vécue sur le fil du rasoir, n’a que peu ou pas du tout de valeur, et où chacun fait sa propre justice, en veux-tu en voilà des clichés, c’est le pays des Indiens, le pays du bout du monde, de la nostalgie de l’Europe, du banzo* de l’Afrique, de la séduction sud-américaine, de la nature luxuriante, de la mélancolie tropicale, tant de soleil, de mer, de ciel, de sexe, de jungle, de sucre, de bois, de perroquets, de poivre, de fruits, de feuilles, d’herbes, de racines et de graines, suffisamment pour remplir les bateaux et les casseroles du monde entier, de la cachaça* – saoulons-nous, tu ne m’offres pas une caipirinha ? –, des mégalopoles tentaculaires comme des caisses empilées véritable escalier vers la Lune, de paisibles villages de l’intérieur recouverts d’antennes paraboliques, des chansons inoubliables, des fêtes populaires, un cierge pour Dieu et un autre pour le Diable, des poètes populaires, des conteurs, d’adorables menteurs, de l’huile de palme, du café, du soja, du guarana, du tabac, de l’or, du pétrole, de la marijuana, des esclaves, le métissage, les grands propriétaires, les mauvaises blagues sur les Portugais, voilà le Brésil, tu perds un ami mais tu ne rates pas une blague, des intellectuels snobs comme les Français, d’ailleurs ils les imitent de la tête aux pieds, des politiciens au baratin facile, sans scrupules, corrompus, fripouilles – est-ce nouveau tout ça ? –, des riches charmants, des riches ignorants, des riches très chics, des riches aussi arrogants et aliénés que les nôtres – je sais de quoi je parle, je suis fils de riche –, tous ou presque tous des prédateurs, qui ne veulent que s’en mettre plein les poches même si pour cela ils doivent piller la terre entière, des millions de pauvres et d’analphabètes qui se laissent rouler par les boniments des nantis et des instruits, et ceux-ci n’attendent que le moment de leur lancer une bombe comme solution finale pour débarrasser le pays des Nègres, des Métis, des Mulâtres et des paysans du Nordeste… des pauvres quoi !, eh oui, ces Blancs bourrés de fric et les nouveaux riches qui ont blanchi leur matière grise, ils considèrent que le retard du pays est dû au mélange des races, et en écho à cela une classe moyenne prise en sandwich entre l’étage du dessus et celui du dessous, barricadée, branchée passivement à la télé et aux ordinateurs, et qui apprend l’anglais en rêvant de fuir tout ça pour aller s’installer à Miami, au Canada, en Australie, vive ce Brésil gigantesque et insensé, pays des Métisses sublimes qui rendraient fou le plus insensible des hommes blancs, de belles femmes à aimer sans fin, même des blondes, pas toutes oxygénées ou idiotes, du football au rythme de la samba, des travestis formatés pour l’exportation, des prostituées qui tombent amoureuses ou qui font parfaitement semblant, des mannequins admirables, des têtes de linotte, des gros seins et des grosses fesses siliconés, qui ont appris à se dandiner dès leur enfance, avec la complicité de leurs tendres mères, de la chair, beaucoup de chair, le Carnaval (René, ô René/ Skindô, skindô/ Qui es-tu ?/ Skindô lé-lé/ René, ô René ! Poil au cul !!!!), tu vois ?, me voici de nouveau heurtant des susceptibilités à fleur de peau, de gâchette, et malgré cela je peux encore devenir un refrain d’École de Samba, il était temps, non ?, c’est ça le Brésil, batucada*, bruit, son d’ivrognes, furie de drogués, mais ici les champions du défilé ce sont les Nord-américains, des cerveaux numériques d’une affligeante ignorance, ils demandent d’emblée combien de dollars cette statue a pu coûter, et si là-bas, de l’autre côté de l’océan, il n’y a pas l’Afrique, allez, profites-en, fais clic-clac toi aussi, regarde-moi, ce que tu vois à présent n’est rien de plus que l’image d’un héros immobile – ou d’un rustre, pour vous les Brésiliens –, quoi qu’il en soit me voici coulé dans le bronze, dans un angle de ces remparts séculaires, exposé publiquement aux touristes du monde entier, comme les putes à demi-nues dans les vitrines d’Amsterdam, alors que faire ?, on m’a accordé cette récompense, c’est vrai, désormais je suis le héros, ou pour mieux dire désormais j’étais le héros, des vicissitudes de l’Histoire qui n’ont pas beaucoup à voir avec la justice du temps où j’ai vécu, avare en reconnaissance, ni avec mes déceptions, mais c’est comme ça, comme désormais j’étais le héros, on m’a figé pour toujours dans cette pose – indélébile, disons-le – de carte postale, qui au premier abord te déçoit, je te parais plus petit que ce que tu imaginais, et un peu bizarre avec ces habits qui me rendent éternel, et mon inévitable perruque – des mèches épaisses, et des boucles ! –, jusqu’à mes nobles petits souliers –, je ne souffre plus de la goutte, quel soulagement –, tu dois penser que je ressemble davantage à un danseur d’opéra qu’au seigneur des eaux et des tempêtes, je sais, tu dois trouver que mon image n’est pas à la hauteur de ma réputation de héraut de la peur et de la terreur, et tu regardes mes mains d’un air moqueur et affecté, moi, l’Épée d’Honneur du Roi, le Chevalier de l’Ordre de Saint-Louis, le capitaine sur mer et à la guerre, le commandant de vaisseaux de la marine française, le chef d’escadre, le lieutenant-général qui crachait du feu par la bouche des canons, moi, René Duguay-Trouin, je ne pouvais pas avoir des doigts aussi fins, comme on peut le voir à travers ceux de ma main droite à demi-ouverte, à tes yeux ils rappellent plutôt ceux d’une fileuse, tu croyais que j’étais un mastodonte ?, or c’est avec la dextérité d’un danseur d’opéra – disons plutôt d’un escrimeur – que je me suis toujours déplacé sur les théâtres de la guerre, grâce à ma vitesse de raisonnement et à la précision de mes mouvements, j’étais devenu un redoutable traqueur de richesses sur toutes les voies navigables où je pouvais rencontrer des ennemis de la France, c’est-à-dire quasiment tous les pays bien armés de l’Europe, moi, René Duguay-Trouin, j’ai attaqué des ports et des villes tombés entre des mains ennemies où il y avait de quoi piller et dévaster, au cours de batailles sanglantes, jusqu’à les ruiner et les démoraliser totalement, si jamais ils ne se rendaient pas dès mes premiers cris et mes premiers coups de feu, en pleine période des guerres de course – mot d’origine italienne, note-le, corso = correre, courir, et cela a duré du Moyen Âge jusqu’au xixe siècle, donc, comme tu peux déjà le voir, ma carrière s’est déroulée à un moment capital, celui des guerres de la Ligue d’Augsbourg et de la Succession d’Espagne, entre 1689 et 1714, c’est là que moi, René Duguay-Trouin, j’ai couru par monts et par vaux après les Espagnols – jusqu’au moment de cette fameuse Succession –, et surtout après les Hollandais, les Anglais et leurs alliés portugais, ces derniers, les pauvres, doivent encore se sentir les plus humiliés et les plus offensés de la terre, par moi-même, car je leur ai infligé une mémorable raclée, lors d’une attaque audacieuse, sinon spectaculaire, sans précédent dans l’histoire des invasions françaises : l’assaut et la prise de Rio de Janeiro, la ville la plus convoitée de l’empire colonial lusitanien, à l’apogée du cycle de l’or venu du Minas que l’on chargeait avant de partir pour Lisbonne.
Ouf ! Il y avait vraiment de quoi y perdre son souffle, quand moi, René Duguay-Trouin, j’ai fait le premier le siège de la ville de Rio de Janeiro, un siège de cinquante jours, en attendant le paiement de la rançon, et avant de libérer la ville et de la rendre à sa population qui, à l’époque, comptait environ douze mille âmes, une population bien pourvue en vivres (cela m’avait beaucoup impressionné), deux mois de provisions venues du Portugal, d’Angleterre, de France, d’Italie et d’Inde. Les maisons ressemblaient à des boutiques remplies de toutes sortes de curiosités venues d’Europe, de Chine, des Indes Orientales, du Japon, de Perse : des porcelaines, des buffets laqués, des miroirs, des cristaux, des tableaux, des chaises en ivoire, des bois odorants, des meubles de style. Et des bougies, beaucoup de bougies. Une opulence que la plupart d’entre nous, les envahisseurs français, n’avaient jamais connue.
Oui, monsieur, j’ai été le seul Français à dominer la ville de Rio, à y devenir roi durant presque deux mois, avec droit aux caresses et aux faveurs d’une belle femme, cadeau d’un curé portugais qui craignait que je veuille rester à Rio. Voilà ce que la peur peut provoquer ! Dans le doute, le prieur, Duarte Teixeira Chaves, prit soin de changer de camp, il devint notre fidèle allié et trahit les siens en nous livrant des informations sur tous les mouvements en cours dans le pays, trahissant Dieu également : ses habits ecclésiastiques ne l’empêchaient pas d’être pourvoyeur de femmes, transgressant ainsi de façon impardonnable un des dogmes de l’Église. Mais il pouvait compter sur ma bienveillance, et sur ma nausée provoquée par les traîtres, malgré leur utilité en temps de guerre. Sauf pour ceux qu’ils trahissent, bien sûr.
Moi-même j’ai été trahi par un Français qui habitait à Rio, un certain Bocage, un corsaire possédant un beau curriculum et qui s’était mis à servir le roi du Portugal. Il s’était prévalu de sa condition de Français pour obtenir des informations qu’il livrait au camp opposé. Les canailles n’ont pas de patrie. Ils n’ont que des intérêts immédiats.