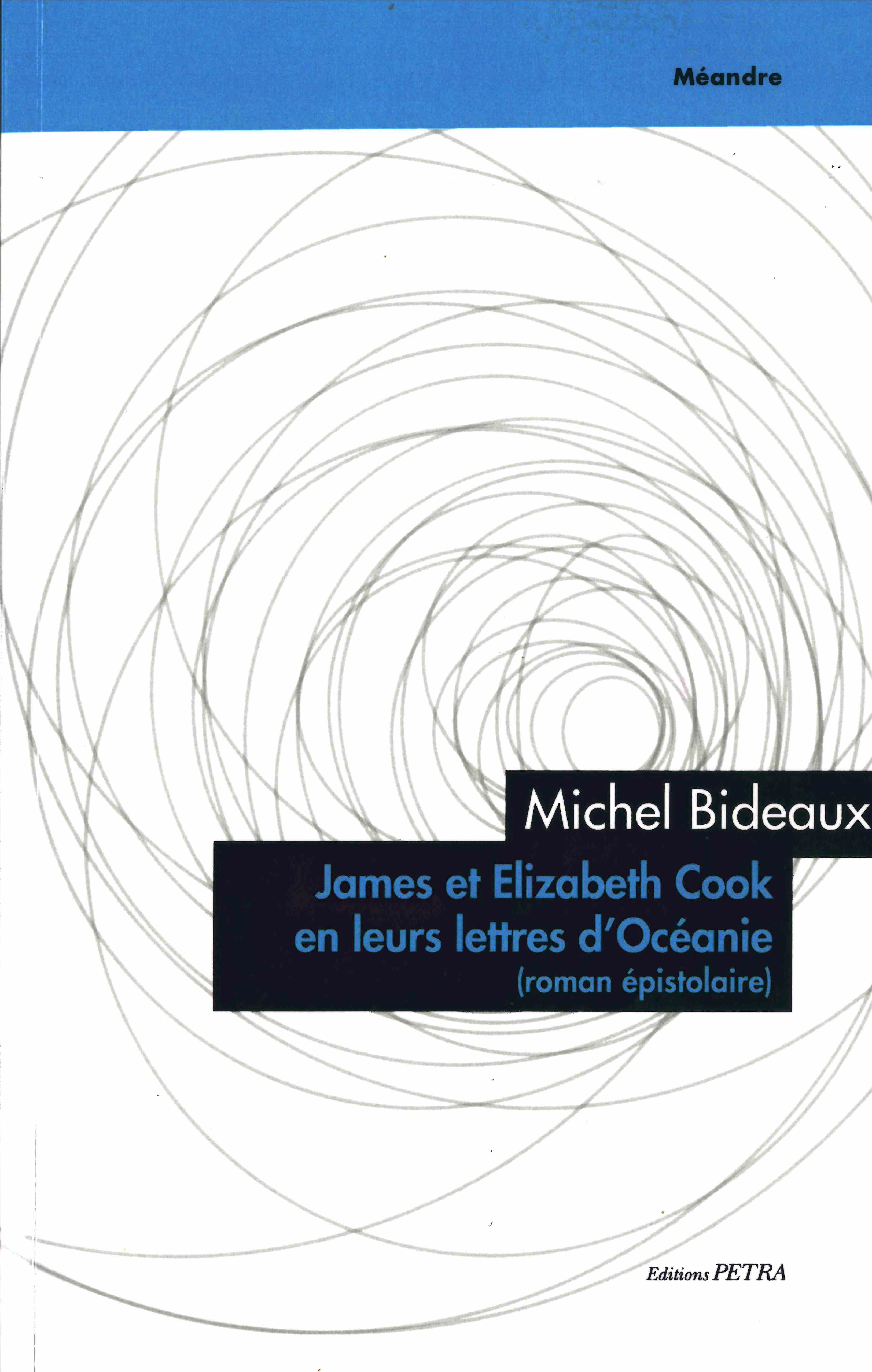-
22.00€
3, puis 3 et encore 4 : dix années au cours desquelles Elizabeth Cook veille sur leurs six enfants pendant que James circuit le globe, va chercher Vénus à Tahiti, s'assure que le continent austral est un leurre, mais voudrait croire que le passage au nord de l'Amérique n'en est pas. Ils ne savent l'un de l'autre que ce que leur apprennent des lettres jetées au hasard des partances ou des escales, exposées au coups de mer et aux contretemps des arrivées ou des départs. Quand le Discovery du capitaine King lui rapporte quelques reliques de son mari que les Hawaïens ont massacré un an plus tôt par malentendu, Elizabeth s'enfouit dans un demi-siècle de veuvage.
Le choeur des biographes vous l'assure : les lettres, toutes les lettres, ont été livrées par elle à la cheminée.
Mais à Nouméa, obstiné comme le caillou où il a pris racine, un jeune Caldoche n'en croit rien. Pour lui, cette correspondance se doit d'exister. Il n'y manque en effet que la preuve.
Début de l'échange épistolaire entre James Cook et sa femme Elizabeth
PREMIER VOYAGE, 1768-1771
James à Elizabeth, de Deptford, le 6 mai 1768
Chère Elizabeth,
Je n’avais pas très bien compris l’intention de M. Hugh Palliser, quand il m’avait demandé d’interrompre mon congé pendant une semaine, pour le rencontrer ici avec M. Michael Lane. Notre ami m’avait semblé alors envisager pour nous une nouvelle campagne à Terre-Neuve, afin d’y compléter nos travaux cartographiques sur la côte sud de l’île. La présence de M. Lane à nos entretiens donnait à penser qu’on me proposerait à nouveau le concours de cet excellent dessinateur. En fait, il s’agissait de tout autre chose.
Hier, en début de matinée, M. Palliser m’a informé qu’avant de retrouver M. Lane, qui n’était pas encore arrivé, nous nous rendrions au siège de la Royal Society. Son Conseil, qui se réunirait tout à l’heure, envisageait de me confier le commandement de l’Endeavour pour le voyage que celui-ci devait entreprendre dans les mers du Sud afin d’y observer l’an prochain le passage de Vénus sur le disque solaire. M. Palliser montrait dans tout son propos qu’il ne doutait pas un instant de ma réponse.
Deux heures plus tard, nous nous trouvions dans une antichambre où le vice-amiral Sir John Campbell, qui allait me présenter à la Société, m’a interrogé sur ma participation à la bataille de Québec et sur mes campagnes de cartographie à Terre-Neuve. À notre entrée dans la salle de réunion, j’ai salué de mon mieux le Conseil et son président, qui m’a posé les mêmes questions, avant d’ajouter quelques mots aimables sur mes activités au service de notre nation ; la décision du Conseil me serait communiquée par M. Palliser. M. Lane nous ayant rejoints au début de l’après-midi, M. Palliser m’a informé que le Conseil avait accepté ma candidature et demandait donc à M. Lane de prendre la tête du Grenville, qui avait été de tous nos voyages à Terre-Neuve. Nous avons passé le reste de la journée à examiner ensemble les dispositions à prendre afin qu’il puisse me succéder pour quelque temps à cet emploi, que je retrouverais à mon retour. Au moment de nous quitter, M. Palliser m’a confié : « Vous aurez à préparer vos proches à cette longue absence. Ne tardez pas à le faire. »
Ce matin, nous sommes donc retournés très tôt à Deptford. La visite de l’Endeavour demande certaines précautions. Depuis le printemps, il importe d’éviter les itinéraires où se rassemblent les marins du port, qui menacent de s’en prendre aux navires si leurs salaires ne sont pas augmentés.
Le navire charbonnier dont l’Amirauté a ordonné l’achat s’appelait l’Earl of Pembroke ; il avait été construit à Whitby, il y a moins de quatre ans, pour M. Thomas Milner, un ami du capitaine Walker. On ne pouvait mieux choisir. Il possède toutes les qualités requises pour notre mission : il est robuste, spacieux et tient bien la mer. J’aime aussi le nouveau nom qui lui a été donné, Endeavour : quelle entreprise pour nous, en effet! Il est un peu plus large que le Freelove sur lequel M. Walker m’avait pris à son service.
Voilà de bien grandes nouvelles, chère Elizabeth ! Tu peux m’écrire ici à l’adresse ordinaire. Je serai à la maison le 12 mai au soir, pour quelques jours seulement, avant que la préparation de l’Endeavour ne me rappelle à Deptford.
Ton mari affectueux,
James.
Elizabeth à James, à Deptford, le 8 mai 1768
Cher James,
Je vois bien que nous n’aurons plus beaucoup de semaines à passer ensemble avant ce grand voyage. C’est une étonnante aventure qu’on te propose là, James. Ton mérite est reconnu, et je suis très fière d’apprendre que notre Marine t’a confié une pareille mission. Cela dit, ne m’en demande pas davantage. J’avais bien sûr pensé à répandre la grande nouvelle lors du repas du soir. Mais la maison n’était pas encore remise de la querelle qui l’avait secouée la veille de ton départ et je ne suis pas sûre d’avoir bien saisi la cause de la colère de ta cousine. Je ne crois pas que le moment soit très choisi pour entretenir les enfants de ta prochaine absence. J’essaierai de t’écrire demain à ce sujet. Je réfléchis, et t’embrasse.
Elizabeth.
Elizabeth à James, à Deptford, le 9 mai 1768
Cher James,
Je n’ai guère dormi cette nuit, mais j’ai du moins pu retenir à table le secret qui brûlait mes lèvres. Après ton départ, Fanny a fini par me confier la raison de son emportement contre le pauvre Ron Preston. Le Révérend les avait vues, Elizabeth Honeychurch et elle, au bras de deux jeunes gens, comme ils sortaient du Parc de Marylebone : « C’est bien là qu’il faut aller chercher les maris ! », lui a-t-il déclaré alors qu’elle l’accueillait sur le seuil pour le repas, ajoutant même qu’il n’approuvait pas trop sa fréquentation d’une fille médisante et qui porte si mal son nom. La chose aurait pu en rester là si, à propos des fêtes de mai et des mariages auxquelles elles conduisent, tu n’avais rappelé à table – sans penser à mal, j’en suis convaincue– combien tu serais heureux de voir notre ami bénir une future union de notre cousine. Et tu n’as pas compris pourquoi elle t’a répondu n’avoir nul besoin pour cela d’un vieux célibataire du Yorkshire.
Ta pauvre cousine avait les larmes aux yeux. « De quoi se mêle-t-il ? Toutes les jeunes filles du quartier ont l’habitude, le premier lundi de mai, d’aller manger des beignets à Marylebone. Nous quittions le café (il n’était pas encore sept heures) quand ces deux garçons nous ont offert de nous raccompagner. Où est le mal ? » Je lui ai donné raison, pensant bien faire en ajoutant que, le jour venu, une jolie brunette avec de gentilles fossettes n’aurait pas à chercher longtemps un mari. Elle ne m’a pas trouvée drôle et je n’ai pas insisté. Je ne te cacherai pas que notre cousine est, de plus, fâchée que tu l’aies toi aussi taquinée à propos d’un mariage. Pauvre Fanny ! Si on lui fait de tels embarras pour une distraction aussi innocente, elle finira par regretter le temps où elle se glissait dans le cortège des laitières qu’un violon, ce jour-là, fait danser devant les maisons pour y recevoir quelques pièces.
« Le vieux célibataire du Yorkshire » est passé nous voir hier soir, pour tenter de se réconcilier avec Fanny, croyant habile de préciser qu’il ne s’offenserait pas si Miss Honeychurch était choisie pour témoin. Elle allait se fâcher à nouveau, mais j’ai pu intervenir et la calmer. Tu en penseras ce qu’il te plaira, mais tu me diras bientôt si les tempêtes qui t’attendent dans les mers du sud sont plus à craindre que celles-là.
J’ai pu informer Fanny de la grande absence qui se prépare. Je l’ai trouvée partagée entre la fierté devant le choix que notre Marine a fait de toi et l’appréhension devant les dangers d’un tel voyage. Mais très vite elle s’est employée à me rassurer et m’a offert tout son soutien jusqu’à ton retour. Elle m’aidera dans les soins du ménage et nous continuerons à apprendre ensemble à lire et à écrire aux deux garçons, comme depuis ton retour de Terre-Neuve. Ce sera l’occasion de vérifier, une fois de plus, que les sacrifices faits par ma mère pour me donner de l’instruction n’ont pas été inutiles, et qu’à la pension de Barking, on ne m’a pas enseigné que les bonnes manières.
J’ai remercié Fanny, comme tu le devines, lui demandant seulement de réfléchir à sa proposition et de te la soumettre. Mais dès à présent, j’y vois beaucoup d’avantages. Restant auprès de nous, Jem et Nat souffriront moins de l’absence de leur papa ; ils ne manqueront pas de camarades de leur âge parmi toutes ces jeunes familles qui sont venues habiter le quartier ; et, bien sûr, nous épargnerons la dépense d’une inscription dans une école de Stepney. Un an d’écart, ce n’est pas considérable : Jem est plus réfléchi, mais Nat très éveillé, il suivra sans peine. Bref, si nous nous sommes trompés, il sera toujours temps de faire un autre choix.
James à Elizabeth, de Deptford, le 28 mai 1768
Chère Elizabeth,
Je reviens à notre conversation d’hier. Il est temps de penser, en effet, aux moyens par lesquels nous pourrons communiquer au cours de cette longue absence. Tu m’as suggéré de t’écrire chaque semaine : pourquoi pas ? Mais pardonne-moi, Elizabeth, voilà bien une idée qui vient de la terre ferme : en mer, nous découpons le temps tout autrement… Cela dit, j’aimerais y réfléchir à nouveau quand je serai mieux informé des conditions du voyage. Depuis que le capitaine Wallis est revenu de son tour du monde, il y a huit jours, je sais que nous devrons nous installer, pour y observer le passage de Vénus (le 3 juin, l’an prochain), sur une petite île qu’il vient de découvrir dans l’océan Pacifique et qu’il a nommée l’île du roi George.
L’Endeavour sera avitaillé pour douze mois et, selon le capitaine Wallis, nous devrions trouver sans peine à cette île les rafraîchissements dont nous aurons besoin, sur place et pour le retour. Peut-être serons-nous, si rien ne vient contrarier nos projets, rentrés ici pour le Noël de la prochaine année.
Je me refuse cependant à admettre que nous restions sans nouvelles l’un de l’autre pendant tout ce temps. Je pourrais sans doute tenir un journal qui te ferait connaître plus tard ce qu’auront été ces mois passés loin des miens ; mais il me faut d’abord rendre à mes supérieurs un compte détaillé des événements de la navigation et des rencontres que j’y aurai faites. Je crains donc que la conduite du vaisseau et de l’équipage ne me laisse guère le temps, de jour comme de nuit, de me consacrer à un exercice pour lequel je ne me sens, à vrai dire, aucune disposition. Et à supposer même, par impossible, que je puisse te remettre à mon retour une rédaction suivie d’un tel journal, ce n’est pas elle qui t’aurait soutenue ou rassurée sur mon compte quand il l’aurait fallu : lors de notre séparation.
Je pourrais bien, encore, t’écrire à loisir quelques lettres que je te remettrais, tel un bouquet, pour fêter nos retrouvailles. Mais j’opposerai la même raison : elles te parviendraient trop tard, et tu serais restée seule tout ce temps.
N’y a-t-il donc aucun moyen de maintenir entre nous quelque lien au cours de cette navigation ? J’en vois un, même s’il n’est pas assuré. Il est des ports auxquels abordent fréquemment nos navires, ou ceux de pays amis : Funchal à Madère, Rio de Janeiro, Batavia, Le Cap sont dans ce cas. Nos autorités s’en servent régulièrement pour acheminer leur courrier, dans les deux sens, et c’est une pratique longuement établie entre les nations maritimes. Il me sera facile de confier à leurs capitaines des lettres à ton intention. De ton côté, tu pourras remettre les tiennes aux services de l’Amirauté, qui les enverra sur le premier navire en partance. M. Hugh Palliser m’a donné toutes assurances à ce propos : il a obtenu de M. Stephens, le secrétaire de l’Amirauté, par qui passent toutes les lettres, qu’il reçoive et transmette aussitôt toutes celles que nous échangerons.
Il y a bien, j’en conviens, quelque incertitude à cette pratique, en raison de la longueur du trajet et de l’ignorance où tu seras du lieu où je me trouverai alors. Mais tu ne peux douter que les gens de l’Amirauté feront tout leur possible, en fonction des informations dont ils disposeront sur le déroulement de ce voyage, pour que ces lettres me parviennent, au port qui conviendra le mieux. À cette fin, je te suggère de leur en remettre parfois deux copies, pour augmenter leurs chances de m’atteindre. Tu me diras peut-être que certaines nouvelles pourront être bien fanées lorsque je te lirai. J’y ai pensé moi aussi, mais il n’importe : écrites de ta main, ces lettres m’assureront que tu as bien reçu les miennes. Notre affection fera le reste.