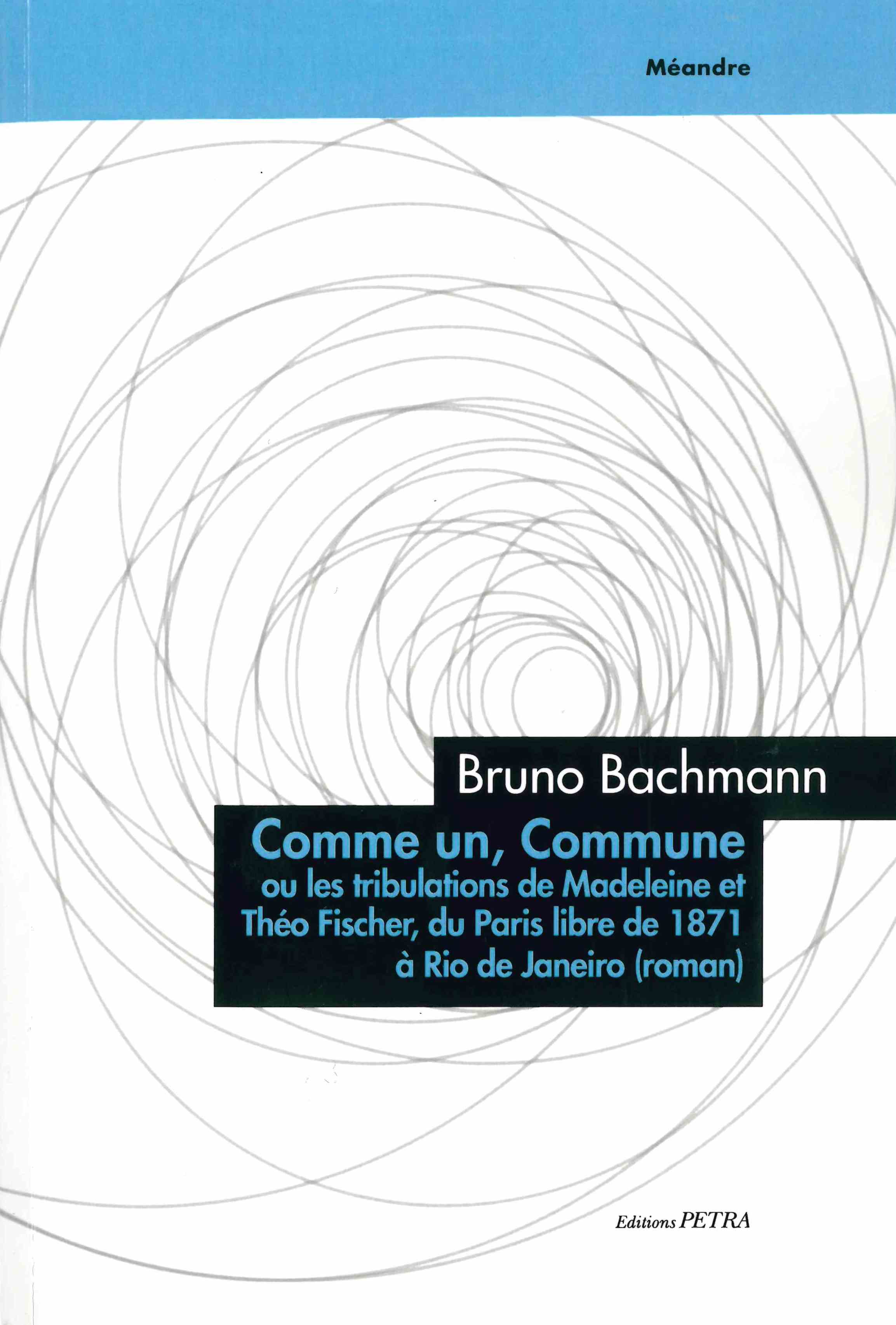-
29.00€
Déporté en Nouvelle-Calédonie pour son activisme sous la Commune de Paris, l’Alsacien Théo Fischer écrit, afin de ne pas sombrer dans la folie, à sa femme, Madeleine, et à son fils, Alexandre, dont il est sans nouvelles depuis le 21 mai 1871. Typographe devenu franc-tireur sous le siège de Paris puis secrétaire de rédaction au Journal officiel de la Commune , Théo nous narre sa rencontre avec sa farouche amazone, son amitié pour François, déserteur exilé au Brésil, la découverte de son frère d’Algérie grâce au musicien Francisco Salvador Daniel, ses altercations musclées avec les policiers Gautier et Mattei, ses combats de rue contre « Oreille-Cassée » et ses sbires – Théo a appris la savate avec le communeux Joseph Charlemont notamment… –, ses missions contre les ulhans aux côtés des Garibaldiens du XIIIe…
Madeleine et Théo nous entraînent dans le Paris de la Commune, quand le peuple, adulte et « las des tyrans », monte à l’assaut du ciel, réinvente la démocratie, sépare l’Église de l’État, rend l’instruction publique gratuite, laïque et obligatoire, instaure l’égalité salariale entre les hommes et les femmes. Autant de mesures politiques censurées par la IIIe République, héritière des bourreaux versaillais.
Avec le clan Fischer, nous croisons la route de Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Gustave Courbet, Eugène Pottier, Jean-Baptiste Clément, Élisée Reclus, Émile Zola, Victor Hugo, Georges Clemenceau, Nadar, mais aussi l’anarchiste Mikhaïl Bakounine, que Théo et ses camarades protégeront du terroriste Netchaïev. Madeleine et Théo nous font redécouvrir Charles Delescluze, Arthur Arnould, Eugène Varlin, Théophile Ferré, Nathalie LeMel, Louise Michel, figures intègres et attachantes d’un Paris révolutionnaire qui illuminera le monde de sa clarté humaniste au point d’être la référence des révolutions du XXe siècle, qui souvent la trahiront en pensant la venger. Mais le martyre de la Commune, dont s’est nourrie la légende rouge chère aux marxistes orthodoxes, vaut en définitive moins que son dynamisme innovateur, joyeux et fraternel qu’illustrent avec esprit Madeleine, Théo, Jeanne, Joseph, Lukas, Henry Bauër, un des fils d’Alexandre Dumas. Dumas ! Et si Comme un, Commune, était avant tout un roman de cape et d’épée ?
Début de Comme un, Commune de Bruno Bachman (chapitre 1)
1
« Les dames à ombrelle ne te martyriseront plus. »
(Automne 1872)
Depuis quand sommes-nous partis de Saint-Martin-de-Ré ? Combien de jours avons-nous passé dans ces entrepôts de la déportation1 ? Nous nous sommes un moment crus oubliés… Un matin, un garde-chiourme m’a hurlé dessus : « Déporté Fischer ? À la visite ! » Rapide et humiliante visite médicale. « Bon pour le départ. » C’est-à-dire « bon » pour la Nouvelle-Calédonie. Nos vieux pères de 48 sont allés « fertiliser » l’Algérie, nous, nous allons, si nous arrivons en vie, servir d’engrais à ce roc des antipodes.
Nous voilà en cage depuis bientôt cinq mois. Nous avons droit à une demi-heure de sortie par jour, sur le pont, sous les filets tendus par des gardiens qui manient l’injure autant que le bâton. Le tout sous les yeux et les coups d’ombrelles des femmes de fonctionnaires qui viennent voir de près à quoi ressemble cette canaille qui a bousculé le Vieux Monde. Nous tanguons, le roulis, les biscuits pourris, le lard avarié, la soif que ne sauraient étancher quelques lampées d’eau salée. Nous sommes en septembre, je crois. En fait, tout a commencé le 4 septembre, avec la proclamation de la République. Deux jours après la capitulation de Sedan et la reddition de Badinguet. C’était il y a deux ans déjà…
Il se murmure que nous pourrions apercevoir le port de Melbourne2 dans quelques jours. Hier, ils ont ouvert la cage une seconde fois en vingt-quatre heures. C’était pour y extraire le corps de Jean le Lyonnais, avec qui je partageais mon hamac.
Quand il n’était qu’un gone, Jean avait vu ses parents canuts se battre, drapeau noir au vent, dans les traboules de la Croix-Rousse. Il avait commencé à travailler à six ans, dans l’atelier familial. Son corps avait été à jamais déformé par le métier à tisser. Peu enclins à la compassion, les fabricants de soie, que l’on appelait ainsi parce que, précisément, ils ne fabriquaient rien mais commercialisaient tout, avançaient qu’on ne pouvait pas payer davantage les canuts. « Vous savez, la concurrence étrangère… » Les soieries lyonnaises représentaient pourtant alors les deux tiers du commerce de la France. À leur révolte nue, on opposa le plomb. Le plomb, Jean le retrouva, quand, à Paris, il participa aux journées de Juin. Là encore, la bourgeoisie fit donner la mitraille. Il avait cependant su échapper à la déportation en Algérie malgré la bosse qui en faisait la cible toute désignée des mouchards. 1831, 1848, 1871, trois révolutions pour un seul homme, quelle vie bien remplie ! À cinquante-deux ans, Jean, tu étais, après Satory et les journées de supplice sous le soleil de juin, un vieillard sans âge. Les dames à ombrelle ne te martyriseront plus…
Aux antipodes, il fait froid la nuit, surtout dans une cage sur le pont d’un navire pestilentiel. Satory et ses pelotons d’exécution étaient moins cruels que cette traversée digne des navires négriers d’antan. Justement, à l’esclavage dans les Îles, les ouvriers de 48 mirent fin, n’est-ce pas, Jean ? J’aurais pu être fier de penser que c’est un Alsacien de Paris, Victor Schœlcher, qui a aidé à briser les chaînes séculaires de nos frères noirs. Oui, mais il fait désormais partie de cette gauche qui soutient les fusillards. Schœlcher vient de se fendre avec Louis Blanc d’une lettre de blâme contre Victor Hugo, qui, de Bruxelles, a protesté contre la déclaration du gouvernement belge, lequel a accepté de remettre les fugitifs aux versaillais. Tandis que de bons bourgeois lapidaient sa maison à Paris et que la Belgique l’expulsait, le journaliste Francisque Sarcey, pourtant un fils de canut, traitait Hugo de « vieux pitre, héron mélancolique, saltimbanque usé, pauvre homme gonflé de phrases, énormément ridicule ». Tout aussi ridicule était de qualifier l’auteur des Châtiments de « manitou de la Commune », lui qui oncques ne sympathisa avec nous. « La Commune est une bonne chose mal faite, écrivit-il. Toutes les fautes commises se résument en deux malheurs : mauvais choix du moment, mauvais choix des hommes. »
Jamais hommes et femmes ne furent plus calomniés que nous, les communeux. Heureusement, des voix de par le monde furent audibles. Au Parlement allemand, le socialiste August Bebel (qui s’opposa à l’invasion prussienne), à la Chambre des communes, Whalley, défendirent la Commune. Aux Cortès, García López s’écria : « Nous admirons cette grande révolution que nul ne peut apprécier sainement aujourd’hui. » Le Congrès des lointains États-Unis s’émut de notre sort. « La Commune appartient à la mémoire des travailleurs du monde entier », proclama l’Internationale, à Londres. Quand les troupes de Von Moltke entrèrent à Berlin pour, croyaient-elles, y être portées en triomphe, les ouvriers allemands les reçurent aux cris de « vive la Commune ! ». Ils furent chargés par la cavalerie impériale.
Jean ne méritait pas cette fin…
1. Les 300 premiers déportés embarquèrent sur Le Danaé le 3 mai 1872. Au total, quelque 3 846 communeux furent expédiés en Nouvelle-Calédonie.2. En relâchant dans le port de Melbourne, L’Orne comptait 300 malades du scorbut sur 588 déportés. En un vaste élan de solidarité, les habitants de la ville rassemblèrent l’équivalent de 40 000 francs pour leur porter secours sous forme de vivres, de vêtements et de médicaments. Le commandant refusa l’aide…