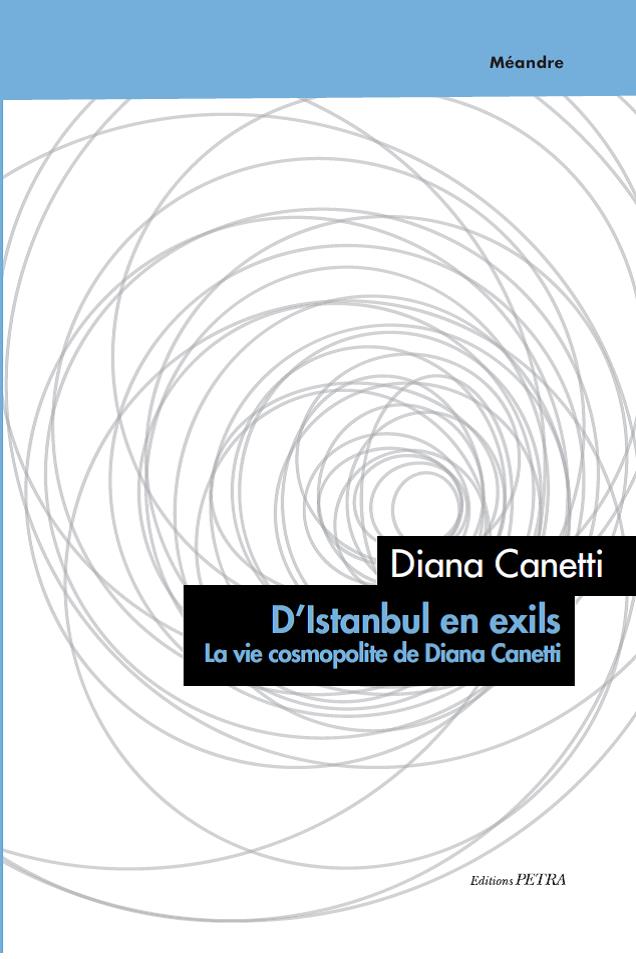-
18.00€
Diana Canetti est née à Istanbul, d'un père juif turc et d'une mère gréco-espagnole orthodoxe. Sa vie commence sous les meilleurs auspices, malgré la Seconde Guerre mondiale: ses parents ont fait un mariage d'amour et les affaires de son père sont florissantes. Mais l'harmonie du couple se lézarde, sa mère fait du "Cercle d'Orient" et ses tables de jeux sa seconde maion où elle côtoie la société huppée et cosmopolite stambouliote. Son frère et elle sont mis en pension. Les pogroms contre les minorités non-musulmanes, la crise économiques font éclater le couple et l'ensemble de sa famille, qui se retrouve dispersée de par le monde. Restée seule, Diana Canetti n'aura de cesse de concilier sa vie de femme, sa vocation d'écrivain et de journaliste ainsi que ses origines aux racines multiples. Elle s'ouvre à la culture française et c'est en français qu'elle écrit ce témoignage d'une enfant puis d'une adulte en proie à l'éloignement et au déracinement.
Début des mémoires de Diana Canetti
La GRECA
Depuis quelque temps mon père avait le pas lent. La journée entière il demeurait assis dans son fauteuil et lisait interminablement son journal. Après dîner je l’accompagnais jusqu’à son lit, je caressais ses rares cheveux, prenais sa main dans la mienne, la serrais et lui disais bonne nuit : « C’est moi l’enfant maintenant. Cela te semble étrange, qu’un vieil homme à la fin de sa vie te parle de chaleur et de douceur maternelle, n’est-ce pas ? Mais ma propre mère est morte quelques heures après ma naissance et je n’ai jamais connu l’amour maternel. Il m’a manqué toute ma vie. C’est Cléo qui m’a donné le goût de l’amour et de l’affection. Quand elle me caressait, c’était comme toi, tout son visage rayonnait. »
Un de ses rares moments d’épanchement. Le visage amaigri, les yeux creusés de mon père composaient un sourire triste et affectueux. Je pris l’album de famille sur l’étagère, commençai à le feuilleter. Une série de photos montrait Cléo en pantalon, avec un chapeau d’homme et une cravate. Une cigarette entre les doigts à la manière de Marlène Dietrich. Je demandai à mon père où il avait connu ma mère. Leur première rencontre. Une question banale, pourtant tous les enfants aiment à la poser : « Elle portait un chapeau de paille d’une taille impressionnante, je n’ai pu m’empêcher de lui dire qu’elle avait l’allure d’une parisienne. C’était après mon retour en Turquie. Je venais d’ouvrir un magasin de vêtements, tout près de la pharmacie de Taksim. Quand Cléo passait dans la grande rue de Pera, tous les regards se tournaient sur elle. Même encore aujourd’hui elle est capable d’éblouir tous ceux qu’elle côtoie. » Quand je l’interrogeai sur mon grand-père, il ne répondit pas tout de suite. Tic-tac de l’horloge.
– Dis-moi, j’insistai, comment a réagi grand-père ?
– À quoi bon te raconter cela ? Tu sais bien que ta mère et moi, nous nous aimions. Mais lorsque j’annonçai à ton grand-père mon intention d’épouser ta mère, il s’emporta. “Greca ? Jamais !” Inutile de poursuivre la discussion avec lui, je sortis avant qu’il ne se mette en colère. C’est la raison pour laquelle nous vivions un peu à l’écart les premières années de notre mariage.
– Tes sœurs, elles méprisaient ma mère ?
– C’était un combat sans fin. Il paraît qu’un jour, Elisa et Rachel rencontrèrent Cléo dans une pâtisserie. On voyait qu’elle était enceinte – je ne sais comment le dire – mais il semble qu’elles lui jetèrent un regard méprisant. Cléo leur tourna le dos et s’en alla. Mes sœurs la poursuivirent et la rattrapèrent dans la rue pour l’insulter. Elles crièrent très fort : “Nous ne mettrons pas les pieds chez toi tant que tu ne seras pas passée par la synagogue”. Cléo, vexée estourbit ses belles-sœurs à coups de sac. Des scènes comme celle-là, il y en eut mille. Rien n’intimidait mes sœurs, Elisa et Rachel, ni les querelles, ni les coups de sac. Quand ton frère naquit, j’étais soldat à Erzurum.
– Alors c’était en 1942.
– Quand j’y pense, l’horreur de la guerre se faisait déjà sentir. Le président de la République İsmet Paşa disait qu’il était neutre. Mais la Turquie avait une attitude germanophile. Il y avait de grandes restrictions. Des queues pour le pain. Tout était rationné. Le sucre, on ne l’achetait qu’avec des tickets. Au début de 1941, tous les hommes entre 25 et 45 ans qui appartenaient à une minorité furent envoyés à l’armée. Aucun de nous ne savait précisément à quoi pouvait servir cette armée. Pendant mon absence mes sœurs firent venir le rabbin et la circoncision de ton frère eut lieu dans les huit premiers jours. D’après ce qu’on m’a raconté, le rabbin semble avoir insisté pour que Cléo se convertisse. Alors, elle qui avait fait de son mieux pendant l’entretien, perdit soudainement contenance.
– Qu’a-t-elle dit ?
– Rien.
– Et alors ?
– Et alors, elle lui a chanté une chanson grecque.
– Sans donner d’explication ?
– Cléo n’aime pas donner d’explication. Pourtant le rabbin, qui ne parlait pas le grec, en comprit parfaitement le sens.
– Que disait cette chanson ?
– Je suis née grecque, je mourrai grecque. Une chanson des résistants grecs sous l’occupation turque. Ma femme est une originale. Cela m’a toujours impressionné. N’empêche qu’il n’est pas facile de vivre avec des originaux.
Mon père soupira.
– Qu’est-ce que tu as, papa ?
– Ce n’est pas du tout le moment, mais je vais t’en parler. En décembre 1942, une grande partie des minorités turques furent ruinées par un impôt sur le revenu « Varlık vergisi ». Quand les huissiers suivis de la police décidèrent que tous les meubles et les matelas, y compris le berceau et les joujoux de ton frère devaient être emportés, ta mère s’accrocha au berceau, ne voulant pas le lâcher. Que voulez-vous faire d’un berceau ? Répétait-elle. “Moi, je peux me coucher sur le plancher... mais mon bébé, où dormira-t-il ?” Mais on ne pouvait ni discuter, ni convaincre ces gens-là. On a été taxé beaucoup plus que les musulmans parce que nous portions des noms juifs. Pour quelques livres manquantes sur une somme colossale, je fus envoyé à Aşkale, au fin fond de l’Anatolie.
Depuis que mon père était chez moi, il dormait dans ma chambre et moi sur le canapé du salon. La conversation l’animait et le fatiguait à la fois, mais il ne voulait pas s’endormir avant la tombée de la nuit. Il voulait que je reste près de lui, même s’il fermait les yeux de temps en temps. J’en profitais pour m’évader dans les photos, comme le faisait ma mère. C’était leur côté commun, cette passion pour la photo et le cinéma. Pourtant je savais peu de chose de ma mère. C’était un puzzle. Il me manquait des pièces. « Femme en pantalon », c’est ainsi qu’on la taquinait. J’examinai le visage de ma mère, son visage, sa belle peau sans ride, ce regard malicieux qui la caractérisaient. Une autre photo la montrait sous les arbres, en train de jouer aux cartes avec ses belles-sœurs. Les jeux de cartes étaient si répandus dans ce petit monde que même les enfants se joignaient à leurs parents. Pourtant, moi, je les détestais. Une fois l’an, on faisait venir le photographe. Il prenait des dizaines de clichés en une demi-heure : la famille en robe de chambre rassemblée au salon, la mère nouant les nattes de sa fille devant le grand miroir de la commode, mère et fille sur le lit de la chambre à coucher, frère et sœur étudiant à la même table de travail. Plus tard, on a déménagé de Cihangir pour un quartier plus luxueux d’Istanbul. Dans le nouvel appartement, on a célébré le dixième anniversaire du mariage de Cléo et Marcel. Chaim, qui en avait voulu à son fils d’avoir choisi « la Greca », a embrassé sa belle-fille et Marcel lui a offert une bague en diamant. « Tout est bien qui finit bien » comme dans un film des années cinquante.
L’entrée de Marcel dans le Cercle d’Orient, club d’élite international de riches bourgeois, d’universitaires et de diplomates, changea leur vie comme dans un film après l’entracte. Ce club, une villa-palais du XIXe siècle, offrait toutes sortes de divertissements : restaurant avec orchestre pour la soirée, restaurant sur la plage dans la journée, ski nautique et roulette au casino. Pendant les vacances d’été, la vie au club était merveilleuse. Quel privilège ! À quinze ans je mangeais à la carte, découvrais la musique classique turque et le jazz américain, je commençais à flirter et me baignais au clair de lune. Autour de moi, une atmosphère baroque, un ballet de serveurs et de maîtres d’hôtel. Bal masqué, langage recherché, jeux de mots. Plaisirs enivrants. C’est dans ce milieu que Cléo découvrit ses lacunes, ses limites. Elle comprit qu’avec son intelligence, elle aurait pu avoir une profession, exploiter ses qualités, atteindre la première branche, se hisser jusqu’au sommet et saisir l’oiseau, son nid et ses œufs d’or. Lorsqu’elle s’en rendit compte, elle en éprouva de l’amertume et des regrets. Elle compensa tout d’abord par son charme et sa beauté. Puis elle se laissa aller. Se réveiller tard, recevoir ses intimes en robe de chambre, s’asseoir devant la fenêtre, siroter un café turc, fumer des cigarettes et suivre le mouvement de la rue, devinrent le rythme lent d’une vie mondaine. Qu’il pleuve ou qu’il neige, elle sortait à trois heures de l’après-midi, comme si elle devait répondre à la sonnerie de l’école. Être au casino de quatre à sept, était pour elle une véritable source d’exaltation. Le sang cognait dans ses veines, lorsque le croupier disait : « Mesdames et messieurs, faites vos jeux ! Rien ne va plus ! »
Ce goût du jeu finit par lui coûter fort cher. S’il entretenait chez Cléo l’espérance fallacieuse de gagner, il vidait chaque jour davantage son porte-monnaie. La vie au Cercle d’Orient se poursuivait sur le même rythme et Cléo continuait à vivre dans son monde : coiffeur, cigarettes, jeu et toilettes, dettes. Pendant ce temps, la tension entre les Grecs et les Turcs s’intensifiait. La menace d’un déplacement de population paniqua les Grecs de nationalité turque. Ils quittèrent Istanbul par milliers, abandonnant tout ce qu’ils possédaient : leurs maisons, leurs magasins, leurs affaires. Tantes, oncles, cousins de Cléo, tous partirent pour la Grèce. Et puis un jour, le club cessa d’être le centre de sa vie. Ce jour-là, quand Cléo reprit connaissance, elle demanda « le rouge ou le noir ? » pour sauver la face, pour ne pas montrer son chagrin, pour camoufler sa souffrance. Elle aimait prendre ce masque de clown qui faisait rire pour ne pas pleurer sur son sort. Le souvenir de ce caractère impossible à déchiffrer, de ce déguisement continuel, me perturba tellement que tout se mit à tourner. L’album de photos glissa de mes mains et tomba à terre. Je sursautai, je me penchai pour le récupérer, mon père ouvrit les yeux.