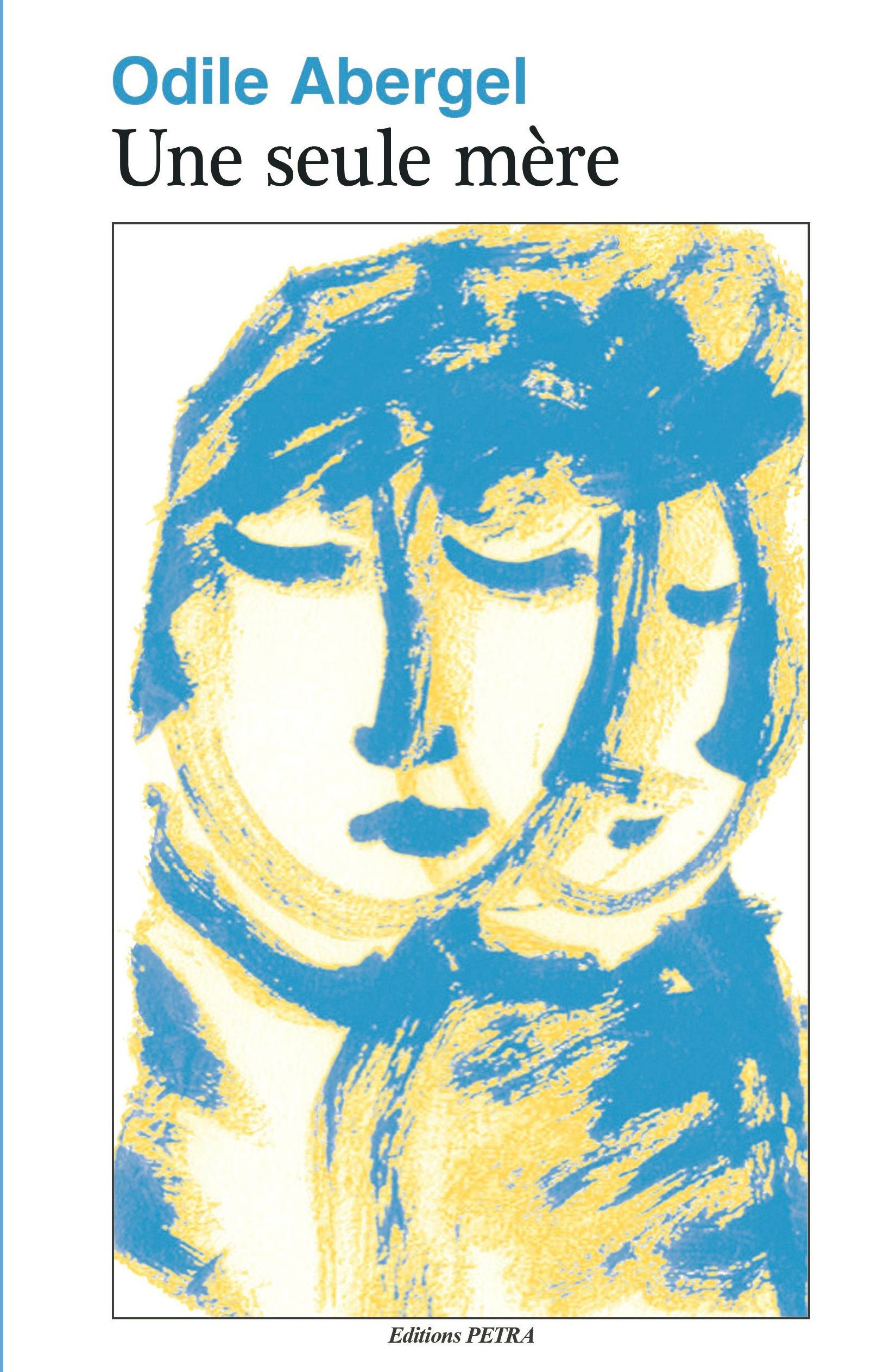-
15.00€
Pourquoi la nature resplendit-elle quand les feuilles tombent ? Et qui reconnaît aux mourants leur beauté d’êtres vivants ? Voici les questions que tu t’es posée, ma fille, en m’accompagnant jusqu’au bout.
Je ne bougeais plus, et toi tu t’agitais, tu rentrais chez toi, tu revenais, tu courais après les infirmières, tu admirais les aides-soignantes Malgré la dégradation de mon état, je restais digne, car je l’étais à tes yeux. Tu me faisais don de ta présence et m’insufflais ta joie, ton rire, moi je t’offrais une tendresse inédite.
Ce livre retrace l’épreuve d’une fin qui dure le temps d’être vécue comme une chance.
Tout commence par une chute. C’est la loi universelle du début de la fin. Et la question se pose de savoir si les vieux ayant tendance à tomber ne seraient pas soumis à l’attraction de la tombe. Je le crois volontiers, car je me suis retrouvée au sol de plus en plus souvent, comme si une force irrésistible m’y poussait. Jusqu’au matin où les pompiers m’ont ramassée inconsciente. J’avais passé plusieurs heures par terre. Je n’avais pas mal, je ne sentais pas le parquet dur et froid, je ne sentais plus rien, même pas la solitude. J’aurais pu rester ainsi un temps infini en flottant au-dessus de mon corps dans l’espace molletonneux, l’espace illimité où tu te trouvais. Tu étais quelque part. J’existais encore un peu et c’était par toi, ma fille, par l’idée de te revoir.
Tu as appris la nouvelle, tu as marché, tu as couru, tu m’as rejointe aux urgences, tu as passé un mois d’été à venir me voir tous les jours à l’hôpital pour me soutenir et me motiver. Enfin, comme j’allais mieux, vous êtes parties en Bretagne. Tu avais appris à prendre de la distance, c’était une question de survie. Et de vie aussi, car tu en avais une, même si Lucie n’était pas le gendre que j’attendais.
Pendant vos vacances, j’ai été admise dans un centre de gérontologie pour récupérer des forces. Je m’entendais bien avec une autre patiente. Je te parlais d’elle au téléphone. Et surtout je progressais grâce à un kinésithérapeute que j’adorais. Mais soudain je n’y suis plus parvenue. Il faisait trop chaud. Tenir debout me demandait trop d’effort. Une nuit j’étais même encore tombée car je n’en pouvais plus de sonner et d’attendre pour aller aux toilettes, j’avais voulu me lever toute seule.
J’étais de nouveau extrêmement faible, mais le docteur ne diagnostiquait pas d’urgence vitale et ne jugeait donc pas nécessaire que tu écourtes tes vacances. Il avait raison. L’urgence, c’était de t’imprégner du grand air loin de moi, d’y puiser de la vigueur pour m’assurer ton soutien jusqu’au bout. Tu inspirais à pleins poumons pour t’insuffler du courage en pensant à mes bronches obstruées. Il n’y avait plus que ton corps et le mien. Ton corps face à l’écume, sans idées, sans métaphore, juste un organisme vivant dans le monde, et le mien un organisme mourant. Le corps de Lucie aussi était là. Tu voulais préserver sa gaieté et ne pas gâcher ses derniers jours de vacances. Lors d’un dîner chez vos amis, tu as eu envie de boire, de t’abîmer. Il t’a semblé découvrir le désespoir, pire que lors des épreuves passées, pire qu’à l’agonie de ton père qui t’était pourtant apparue insoutenable. Mais justement, à présent tu savais : l’impossible était la réalité. Quant à la vie, elle n’était que la peau, la chair, les poignées d’amour sur les os. Cela motive à bien manger avec les amis, à boire, et à se faire encore une crêperie avec Lucie avant de rentrer à Paris pour me retrouver gisant sur le flanc.
L’image de ce corps le temps de me reconnaître dans la pénombre, l’image de ce corps le temps d’une question béante : combien de trains et de paysages, d’éclats de joie face à l’océan, combien de marées se sont déployées durant les heures étales, les jours identiques dans cette chambre ?
Je confondais les jours mais tu étais là, tu incarnais de nouveau le présent.
Après ton rendez-vous avec le médecin, tu es revenue auprès de moi. Tu avais débronzé d’un coup mais je ne l’ai pas remarqué. Il faut qu’on parle, m’as-tu dit. Tu as commencé par poser le constat de mon incapacité à me lever toute seule, mais cela ne m’inquiétait pas car je faisais confiance à mon kiné. Je le trouvais très beau. Tu m’as expliqué que, aussi beau et compétent qu’il soit, il ne pourrait pas me remettre sur pied du jour au lendemain. Par ailleurs, le docteur t’avait dit que je ne pouvais pas rester plus longtemps dans son service car d’autres malades attendaient. Tant mieux, t’ai-je répondu, je rentre chez moi ! Et comme tu revenais sur mon inaptitude à tenir sur mes jambes, que tu évoquais mon besoin d’oxygène, je t’assurais qu’il n’y aurait aucun problème car Merline s’occuperait de moi. Non, me disais-tu, Merline ne venait que deux heures par jours pour les courses et le ménage, et nous n’avions pas les moyens de prendre quelqu’un à demeure. J’affirmais que deux heures suffisaient largement quand tu as évoqué l’idée d’une maison de retraite. Pas question, tu savais bien que j’excluais cette possibilité, je voulais rentrer chez moi, il fallait appeler Merline pour la prévenir, tout se passerait très bien avec elle.
Comme je ne voulais pas comprendre, comme le médecin ne pouvait pas me garder et t’acculait à prendre une décision, tu as changé de ton :
— Écoute, maman, tu as le choix entre deux possibilités : ou tu vas en maison de retraite, ou tu rentres chez toi et tu risques de te tuer en tombant.
Tu m’as vu fermer les yeux comme j’aurais pu me boucher les oreilles. Et tu as continué de parler face à mon visage crispé dans le refus de faire encore partie d’un monde où ma fille me demandait de choisir entre deux façons de mourir. Je n’étais déjà plus capable de me décider entre compote de pommes ou de poires, mais je devais opter pour la déliquescence accompagnée ou l’horreur en solitaire. Pas d’autre choix. Tu t’entendais prononcer ces mots-là, ils résonnaient comme des coups sur ma figure, tu entendais ta propre voix d’adulte débiter ces paroles, après avoir prononcé tant de mots dans ta vie, avoir appris à parler petite fille. Je gardais mon visage verrouillé, les yeux clos, le noir assourdissant m’était plus doux que de te voir m’imposer cette alternative. Alors tu as enchaîné des phrases pour maintenir un son, pour que ta voix au moins me rassure même si je restais sourde à ce que tu disais. Tu as dérivé sur d’autres paroles, tu m’en as bercé pour me faire rouvrir les yeux… — Maman, m’as-tu dit, tu me fais confiance n’est-ce pas, tu sais que je ne te pousserais pas à faire un mauvais choix, tu sais que je ne t’abandonnerai jamais… Ne t’inquiète pas, de toute façon c’est toi qui choisiras…
Tu as ainsi fini par m’arracher un consentement.
Tu es rentrée chez toi, l’avenir te pesait mais l’espace te permettait de fuir. Je te devine dans la rue, je te vois téléphoner à Lucie : tu lui racontais ce qui s’était passé, tu lui disais que non, tu ne te sentais pas coupable, il n’y avait pas d’autres solutions, tu le savais, oui tu allais devoir chercher un ehpad mais aussi tout réorganiser chez moi avec Merline pendant les mois où je serais sur liste d’attente, réinstaller l’oxygène, chercher une infirmière, rappeler ma kiné, oh oui la Bretagne à peine quittée n’avait peut-être jamais existé. Tu revoyais mon visage hurlant la bouche fermée. J’aurais voulu ne dépendre que de toi, c’est pourquoi tu avais été si dure. Malgré le grand âge dont j’étais victime, tu me tenais rancune de mon dépérissement volontaire, de toutes mes cigarettes fumées sous prétexte d’être libre, car la contrainte de me soutenir finissait toujours par t’incomber. Toi aussi tu avais droit à ta liberté. Tu partais, tu t’éloignais, tu tranchais en deux parties définitivement désunies la symbiose dont je rêvais encore. Tu étais une enfant devenue grande, libre, et pourtant la rue n’était que déchirement sous le ciel toujours là, toujours bleu, le ciel bête comme tes pieds, comme un pléonasme de la vie telle qu’elle est. Tu marchais les yeux arrimés au trottoir sans rien attendre de l’univers autour. Ce bel indifférent ne te serait d’aucun secours, tu le savais, tu savais déjà tout. Ton périple dans ma finitude ne faisait que commencer mais tu savais que rien ne changerait et qu’à la fin de l’histoire, quand je ne serai plus, le monde t’accueillerait dans une pérennité complice. Un jour, dans cette rue ou bien une autre, tout, même le scooter qui klaxonnerait pour gagner une seconde, même le feuillage de l’arbre planté là pour représenter la nature, tout bruisserait de l’air entendu d’une vie qui continue. Et tu te fondrais à ce monde que j’avais connu, dans la lumière du soleil qui m’avait éblouie.
Le lendemain, mon état s’est brutalement dégradé. Je te voyais discuter avec le docteur. Il m’accordait une semaine supplémentaire avant de rentrer chez moi ou de retourner à l’hôpital, mais pas plus, précisa-t-il. Tu aurais voulu comprendre ce qui m’arrivait mais il te rassurait sans avoir le temps de te répondre avec précision et il courait vers une autre chambre. Moi je ne comprenais rien, je m’en foutais de tout ça, car j’étais entre de bonnes mains.
Diane m’expliquait chacun de ses gestes : — Là je vous pose une perfusion avec un antibiotique, Madame Mareli, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire mal… Là je vous mets un peu d’oxygène… Je me laissais faire, j’étais subjuguée par sa coiffure, ses rajouts de tresses dorées, et je ne m’inquiétais pas le moins du monde, un peu comme si ce corps dont elle s’occupait n’était pas le mien. Toi par contre, tu craignais une énième décompensation cardiaque ou respiratoire. Tu ignorais la signification exacte de ces mots, mais tu la redoutais. — Non, disait Diane, ce n’est pas si grave, il s’agit juste d’une infection des bronches, Madame Mareli devrait aller mieux dans quelques jours. — Mais, ajoutais-tu en la suivant dans le couloir, ma mère est très absente aujourd’hui alors qu’hier je discutais avec elle. — Oui, répondait Diane avec douceur et fermeté, mais ne vous inquiétez pas, les constantes sont bonnes. Sans avoir le temps de demander le sens de ces termes, tu revenais près de moi rassurée et pleine de gratitude pour les secondes qu’elle avait bien voulu t’accorder entre deux portes.
Obtenir l’aumône d’une explication en coup de vent deviendrait bientôt ton défi quotidien. Tu pressentais ce futur réjouissant mais l’urgence te rivait au présent. Tu entreprenais l’organisation de ma prise en charge à domicile et tu effectuais des recherches concernant les ehpad autour de chez toi. Certains étaient privés, d’autres publics, leurs prix variaient. L’assistante sociale t’a donné les coordonnées d’un Monsieur que tu pouvais appeler si tu avais besoin de précisions. Il a pris le temps de t’écouter, de te conseiller, de répondre à tes questions. Il s’est ému des difficultés que tu rencontrais dans ce moment si difficile, il s’est même ouvert sur son inquiétude pour sa propre mère… — Oh, quel soulagement de pouvoir parler avec vous, t’es-tu exclamée avant de recevoir la liste des établissements qu’il te proposait de visiter en t’y accompagnant. Tu as découvert leurs sites : certains se situaient loin de chez toi, d’autres semblaient pauvres en infirmiers et en médecins, d’autres affichaient des tarifs trop élevés. Tu as googlisé ce gentil Monsieur et tu as compris qu’il était rémunéré à la commission. Le constat s’imposait : je ne représentais plus rien dans la société humaine qu’un cas prévisible, le cœur de la cible mourante. Et toi ma fille, tu en étais réduite à te livrer à n’importe qui comme à un ami, à un frère. Certes, la gentillesse du monsieur ne le dispensait pas de gagner sa vie, mais cette infime désillusion t’a accablée. Tu t’es couchée tôt, comme quand tu étais enfant, à l’âge où le timbre de ma voix dans la pièce d’à côté te berçait, à l’âge où tu espérais encore l’arrivée d’un frère ou d’une sœur.
Dans le bus le lendemain tu fixais le ciel ou tes pieds mais tu te détournais des autres passagers, de leurs têtes exposées aux reflets baveux du soleil, ces têtes confites dans leur chair, dodelinant dans leur insouciance butée. Comment faisaient tous ces gens pour exister ? Ils avaient des mères eux aussi, ils avaient des morts, ils avaient des têtes avec leurs expressions singulières. Non, tu ne pouvais pas t’ouvrir à l’émotion de nouveaux traits.
Je sais tout cela. En retraçant le passé je te redécouvre, je traverse ce que tu as vécu, je revis par toi, toi qui souffrais tant de m’abandonner à mon sort.
Tu fusais hors du bus, inquiète de l’état dans lequel tu allais me découvrir. Mais Diane et le docteur ne s’étaient pas trompés, j’allais déjà beaucoup mieux. Tu talonnais quand même Diane pour savoir si l’antibiotique avait vraiment fait son effet, si tu pouvais te fier à ma forme apparente. Tu croyais encore aux bilans sûrs, aux prévisions stables. Oui, Madame Mareli va bien aujourd’hui, te répondait-elle, superbe et souriante, un peu gênée aussi car à chacune de ses apparitions, je m’émerveillais de ses tresses dorées et l’en félicitais. Toi, tu irradiais de tous mes sourires mais, ce faisant, tu pensais au supplice de mon retour à la maison.
Depuis combien de temps n’avais-je pas été aussi enjouée ? Mes années de veuvage m’avaient aigrie et je vivais recluse. J’avais besoin d’être prise en charge, ce constat s’imposait, mais il fallait aussi que je retrouve un entourage comme dans ce service, avec le personnel et les autres patients. J’avais mes préférés et je désirais qu’ils m’apprécient en retour.
Alors que tu n’y croyais plus, le docteur t’annonça que nous allions peut-être avoir de la chance : les travaux de rénovation de l’Unité de Soins de Longue Durée venaient juste de se terminer. L’usld allait donc rouvrir dans les trois jours et de nouveaux lits seraient sûrement encore libres. Il allait se renseigner. Mais d’abord tu devais lui dire si tu voulais que j’aille en usld plutôt qu’en ehpad. L’avantage de l’usld, c’était la surveillance médicale permanente et un plus grand nombre de médecins, d’infirmières, d’aides-soignantes. Le désavantage, c’était l’état bien plus dégradé des patients… Mais justement, il lui semblait que mon cas pouvait correspondre à l’usld car j’étais bpco ! Ce sigle-là, il n’avait pas besoin de te l’expliquer. La Broncho Pneumopathie Chronique Obstructive était la maladie des fumeurs, de tous ceux qui n’étaient pas morts d’un cancer du poumon, une maladie réunissant la bronchite chronique et l’emphysème, une maladie obstruant les bronches et détruisant les alvéoles pulmonaires, une maladie m’ayant provoqué une insuffisance respiratoire et cardiaque, m’ayant fait tousser depuis toujours, pour le moins depuis ton enfance, m’ayant expédiée en réanimation, là où j’avais été obligée d’arrêter de fumer, puis, deux ans plus tard, suite à mes chutes, m’ayant fait atterrir en pneumologie où la cheffe de service t’avait notifié la gravité de mon état et conseillé d’en informer tes frères et sœurs si tu en avais.
La décision fut prise de me placer en usld. Mon dossier médical le justifiait et l’extension du service offrait de nouvelles places. Quelle chance dans notre malheur ! La formulation fait mal quand le malheur est trop grand. Mais il s’agissait bien de chance, de soulagement pour toi, car mon placement allait s’effectuer directement, sans rester des mois sur liste d’attente, sans que tu aies à assumer mon retour à domicile durant ce laps de temps. Le malheur concernait tout le reste. Tu l’as compris en interrogeant Diane, en constatant sa non-réponse, en la voyant évoquer avec allégresse la modernisation du bâtiment. Elle se réjouissait surtout de la couleur des murs.
La veille de mon transfert, tu es allée voir l’usld pour te rendre compte par toi-même. Quand Lucie t’a demandé pourquoi cette visite te rendait si triste, quand elle s’est inquiétée de savoir si l’établissement te plaisait, si tu préférais en chercher un autre, tu n’as pas su lui expliquer, tu as parlé des couleurs toi aussi, un étage jaune, un bleu, un rouge, tu as parlé de modernité, et c’était ta façon de pleurer. Tu n’aurais su dire ce que tu avais vu, d’ailleurs tu n’avais rien vu à part un lit encore vide dans lequel tu m’avais imaginée mourir, d’autres déjà occupés, et peut-être une aide-soignante poussant un chariot de couches, peut-être un filet de bave à la bouche d’un homme en fauteuil, à moins que tu aies entendu une voix réclamer de l’aide. Tu ne savais plus. Mais les couleurs des murs tu les avais vues, de cela tu étais sûre. Tu étais restée au bout du couloir et tu n’avais pas bougé. Quelques mois plus tard, une petite dame avec un manteau de fourrure comme on n’en fait plus s’est trouvée à la même place que toi ce jour-là. Elle a découvert le lit vide destiné à son mari dans la chambre en face de la mienne, puis son regard s’est posé sur moi un instant, et il s’est suspendu aux murs dont la couleur n’émerveillait déjà plus personne. Elle ne pleurait pas elle non plus, elle rapetissait dans son vison démodé.