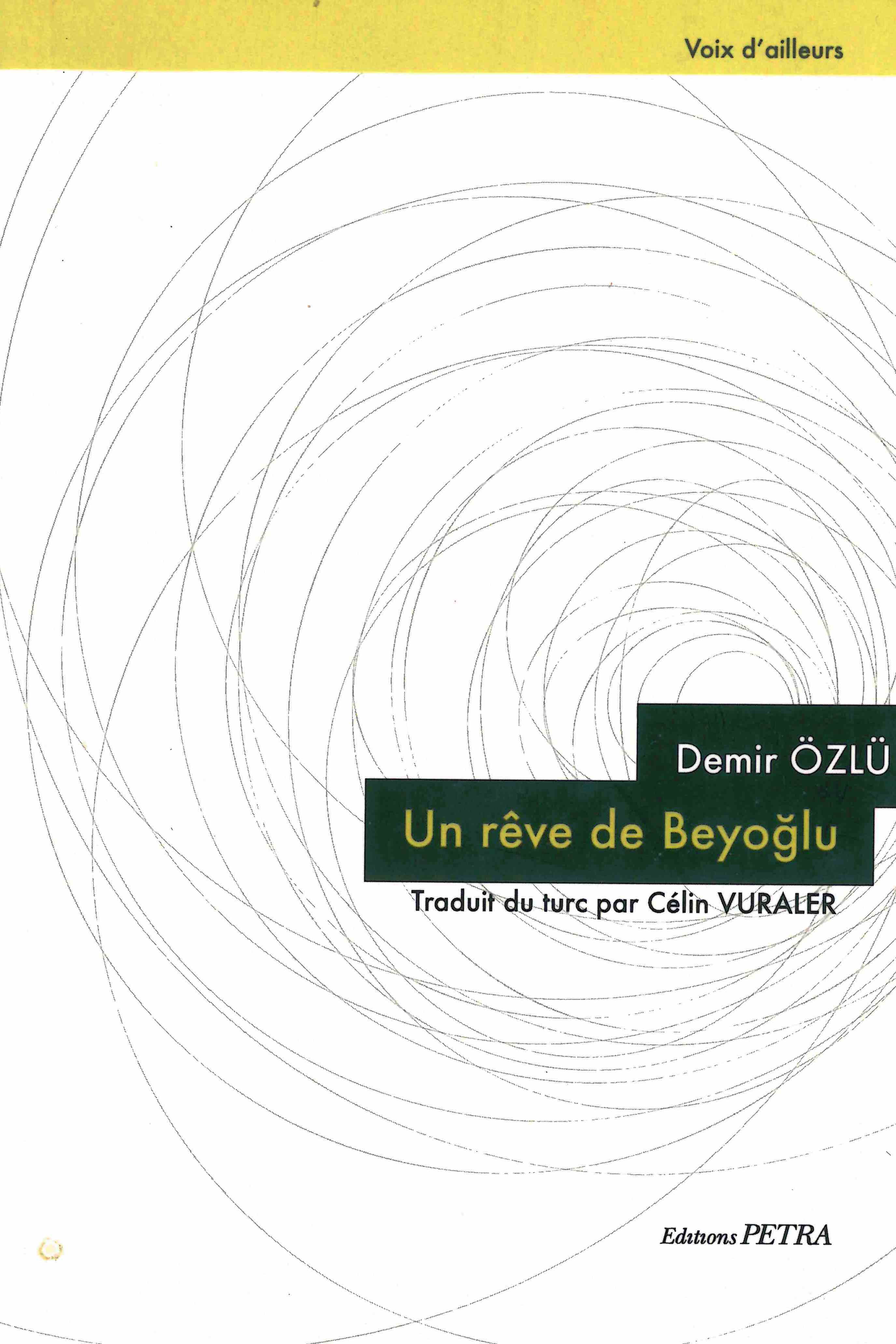-
9.00€
Fasciné par les ombres du passé cosmopolite de la ville, sous la houlette du Comte de Lautréamont et de la Nadja d'André Breton, le narrateur de cette errance sentimentale et architecturale plonge dans les mystères des quartiers francs d'Istanbul. Entre le Péra d'autrefois et le Beyoglu d'aujourd'hui, il fait l'expérience de la solitude et croise un amour aussi sombre que les façades des immeubles rongés par le temps...
Début de Un rêve de Beyoglu de Démir Ozlü
Depuis mes lointaines années de jeunesse qui ont vu ces événements étranges se dérouler, dans cette mystérieuse ville d’Istanbul qui déploie ses horizons innombrables au carrefour de plusieurs mers et s’étire en douces collines sur les rives du Bosphore et de la Corne d’Or, aucun lieu ne m’a autant marqué que la Place de Tünel. J’y suis régulièrement retourné pour essayer de comprendre ce qu’elle avait à me dire, je l’ai contemplée, à différentes époques de ma vie ; même lorsque l’éloignement m’empêchait de m’y rendre, elle s’animait dans mes pensées. J’ai rêvé cette place sous la pluie. Quand je montais dans le petit wagon à Karaköy et que je sortais en haut, à Metro Han, j’étais à chaque fois surpris de la faible étendue de la place. Ce lieu est resté ancré au fond de moi, même des années plus tard, loin d’Istanbul, dans les plaines d’Europe du Nord, sous les grands arbres d’une maison nordique. Son image a souvent occupé mon esprit, elle m’a suivi jusque dans mes déambulations dans la chambre du troisième étage, lorsque j’étais allongé à moitié endormi sur le lit, ou au cours de mes rêveries devant la fenêtre donnant sur les arbres du jardin.
Aujourd’hui encore, à un âge avancé, après une longue vie partagée entre prison et exil, j’en garde le souvenir précis. Je me sens pris par l’envie d’y retourner, de nouveau. Comme si je voulais fouler le sol goudronné de cette place – en fait à peine plus large qu’une avenue –, surgie de l’Istanbul sombre et pluvieuse qui fut le cadre de toutes les affres et mélancolies de ma jeunesse. Ce n’est pas, je crois, ma nature inquiète ni mes sentiments qui m’ont alors détourné de mon chemin, mais le dédale des rues de cette ville – à commencer par cette place –, la diversité des quartiers qui les accueillent, leurs chaussées aussi souvent étroites que larges, les passages et les escaliers partout essaimés. Cependant, quel qu’ait été mon état de confusion émotionnelle, et même si j’ai exagéré la charge de cette ville dans les événements que j’ai vécus, je pense finalement avoir choisi tout ce qui m’est arrivé. Comme lorsque j’ai choisi de quitter la maison familiale pour louer quelque chose au dernier étage d’un vieil immeuble délabré, à côté de la Place de Tünel, dans la rue derrière le passage.
En provenance de Karaköy, je sortais de la station en haut de la ligne par la porte assombrie de l’ancien Han, traversais le Passage de Tünel abrité sous un bâtiment ancien en vis-à-vis, puis, parvenu à l’arrière du passage tout de suite à droite, en face, je regagnais l’immeuble où j’habitais. Un peu plus loin au-delà de son large porche, se trouvait la brasserie Fischer et son imposant bar à bières. La rue s’allongeait sur quelques mètres devant l’entrée de la brasserie et débouchait sur la Place de Tünel, à l’endroit où elle s’élargit. Ici, les taxis faisaient arrêt pour déposer leurs passagers et les tramways en direction de Şişli, Kurtuluş et Harbiye partaient du trottoir d’en face. Ainsi, je m’étais installé dans cette rue, au cinquième étage d’un immeuble auquel j’accédais en me cramponnant aux rambardes en bois de l’escalier vétuste. Cet appartement faisait partie d’un de ces vastes ensembles construits au siècle dernier par des architectes français, dans une toute petite rue nichée en contrebas du Passage de Tünel.
Des années plus tard, quelque part en Europe du Nord, installé au troisième étage dans les combles d’un immeuble ancien entouré de grands arbres, lorsque je songe à mes angoisses d’autrefois, je ne trouve aucune réponse simple à ma condition passée. M’éloignant de la Place de Tünel, je marchais vers Beyoğlu, cherchais des livres d’auteurs modernes dans la librairie Hachette située dans un immeuble sur la droite, je me repaissais de la beauté des femmes qui se promenaient dans la rue, puis de nouveau angoissé, retournais dans ma grande chambre. Là, je me mettais à lire et essayais d’écrire, puis je préparais mon déjeuner et attendais le regain d’activité en fin d’après-midi pour sortir dans la longue rue bondée de monde. Je travaillais à côté de la fenêtre en regardant les immeubles levantins qui inondaient tout ce grand quartier d’Istanbul, gris en hiver, sous la bruine et un ciel couvert. Cet appartement était pour moi un lieu sûr où je me mettais à l’abri de l’âme sombre de cette ville que je n’avais pas encore réussi à pénétrer, de ses habitants et de l’avenir incertain qui se profilait devant moi. Parce que mes promenades de fin d’après-midi dans la rue İstiklâl ne faisaient que raviver l’angoisse et la sensation de vacuité qui m’habitaient, même lorsque je me réfugiais dans les pâtisseries éclairées que des gens bien habillés fréquentaient, chez Lebon et Markiz, ou un peu plus haut dans la rue, chez Baylan.
J’avais quitté le faubourg musulman situé sur la rive d’en face pour emménager à Beyoğlu, avec ses églises, ses lieux de divertissement et des gens qui parlaient une multitude de langues. Ce vieux quartier animé et obscur était un milieu encore peu familier. C’est à ce moment que j’ai rencontré ma voisine : cette femme mystérieuse, des yeux verts qui semblaient discerner l’invisible, et dont la sensualité était manifeste sous son imperméable léger. C’était un soir, alors qu’elle ouvrait la porte de son appartement.